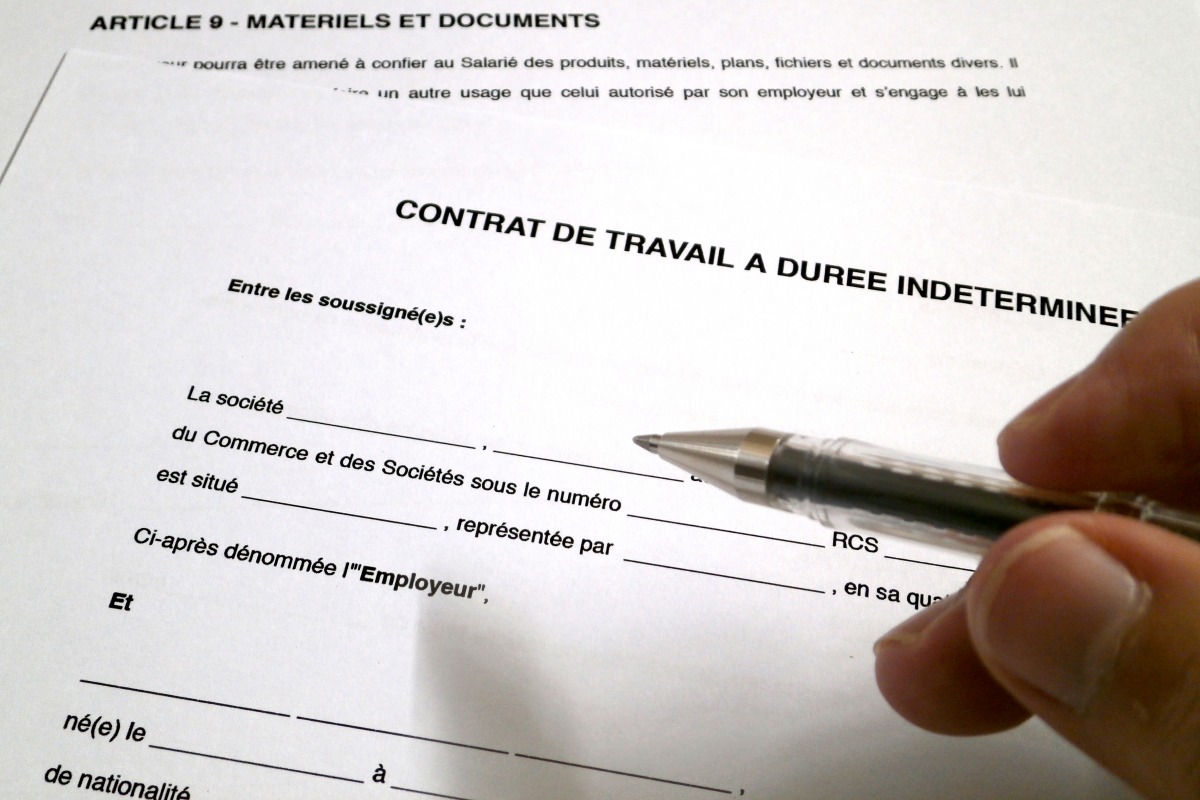Le constat : un absentéisme assez élévé, mais stable
Selon un baromètre réalisé par l’IFOP pour Malakoff Humanis rendu public au début du mois de juin 2025, 42 % des salariés se sont vu prescrire un arrêt maladie en 2024. Ce taux est stable par rapport à l’année 2023. Les populations de salariés les plus touchées par ces arrêts de travail sont, comme en 2023, les jeunes (49% chez les 18-30 ans) et les managers (53%). Une autre tendance révélée par la récente étude est que les arrêts de courte durée (1 à 3 jours) progressent alors que ceux de moyenne durée (4 à 30 jours) sont en recul. S’agissant de la typologie de ces arrêts, après les arrêts pour maladies ordinaires, les troubles psychologiques et/ou l’épuisement professionnel constituent le deuxième motif d’arrêt de travail en 2024.
Les répercussions : des coûts financiers et humains
En 2025 plus que jamais, le coût direct de l’absentéisme s’est accru compte tenu de la baisse de la prise en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS). Les principales autres mesures impactant le coût de l’absentéisme sont la fin de l’indemnisation par la sécurité sociale des périodes non prescrites entre deux arrêts ou encore l’abaissement du plafond de revenus pris en compte dans le calcul des IJSS (qui est passé au 1er avril 2025 de 1,8 à 1,4 SMIC).
Il en résulte pour l’employeur, tenu à une obligation de maintien de salaire, un impact mécanique de hausse du montant à verser au salarié absent, le maintien de salaire étant déterminé sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. Les mêmes causes entrainant les mêmes effets, les indemnités complémentaires versées par l’employeur au titre de la prévoyance complémentaires connaissent le même sort.
En outre, l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 mettant en conformité le droit français avec le droit européen, et permettant l’acquisition de jours de congés payés durant les périodes d’absence maladie, a également accentué le coût des arrêts de travail.
Un autre effet, plus indirect mais tout aussi significatif, réside dans la désorganisation des équipes en cas d’absence d’un collègue de travail, et l’inflation subséquente des risques psychosociaux des collaborateurs qui « absorbent » les missions des salariés absents.
Prévenir l’absentéisme par la mise en place de plans d’action
Face à ce taux d’absentéisme qui se stabilise ces dernières années, l’enjeu pour les entreprises est de mettre en œuvre des plans d’action visant à prévenir l’absentéisme. Cette démarche s’articule autour de deux grandes étapes : une phase de diagnostic suivie d’une phase d’action.
Dans un premier temps, il s’agit de quantifier le taux d’absentéisme et d’identifier les causes profondes de ces absences. Le second temps du process va conduire l’entreprise à actionner différents leviers visant à améliorer la lutte contre les risques professionnels, à mettre en place des procédures de remplacement service par service, à travailler sur la QVT et sur la rémunération variable, … Le risque que constitue l’absentéisme étant multifactoriel, les réponses à y apporter dans le cadre d’un plan d’action sur-mesure sont diverses et doivent être adaptées à la taille et à l’activité de la structure. La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) étant une démarche RH proactive et intégrant une dimension dynamique et individualisée des parcours professionnels, elle répond parfaitement à l’objectif de conciliation de la performance économique et du développement des salariés.
Tenir compte des spécificités des jeunes actifs et des managers
Les données de l’absentéisme des jeunes actifs et la proportion des arrêts prescrits pour des motifs psychologiques illustrent le fait que la santé mentale de ces salariés semble fragilisée au contact du marché du travail. Les chiffres sont parlants : 66% des jeunes de moins de 30 ans déclarent avoir un emploi stressant (contre 54% pour l’ensemble des salariés) et 23 % d’entre eux déclarent vivre une situation d’isolement en télétravail (contre 16% de l’ensemble des salariés).
L’étude publiée est toutefois moins alarmiste qu’elle n’y parait. Elle confirme que les attentes des jeunes générations face au travail portent principalement sur une demande d’évolution du contrat de travail (reconnaissance, souplesse et flexibilité dans les horaires), un besoin de dialogue (repenser le management intergénérationnel), un nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale… c’est-à-dire des sujets connus de l’entreprise mais dont il est impératif de se saisir afin de réconcilier rapidement performance et santé.
Les managers étant considérablement concernés par les arrêts de travail selon l’étude commentée, leur place et le contour de leurs missions constituent un enjeu du plan d’action à envisager pour prévenir l’absentéisme et renforcer l’engagement au travail.
Agir face à l’absentéisme : des outils existent !
Différents dispositifs existent afin de maintenir un lien pendant un arrêt de travail et ainsi mettre fin à l’idée répandue selon laquelle il serait strictement proscrit d’échanger avec un salarié absent. L’objectif est ici de préparer la reprise du salarié par exemple en lui proposant un entretien de liaison, en lui présentant la visite de pré-reprise, le temps partiel thérapeutique ou encore l’essai encadré.
Si l’absentéisme au travail est une réalité, il n’est pas – et ne doit pas être – une fatalité pour l’entreprise !
Crédit photo : iStock.com