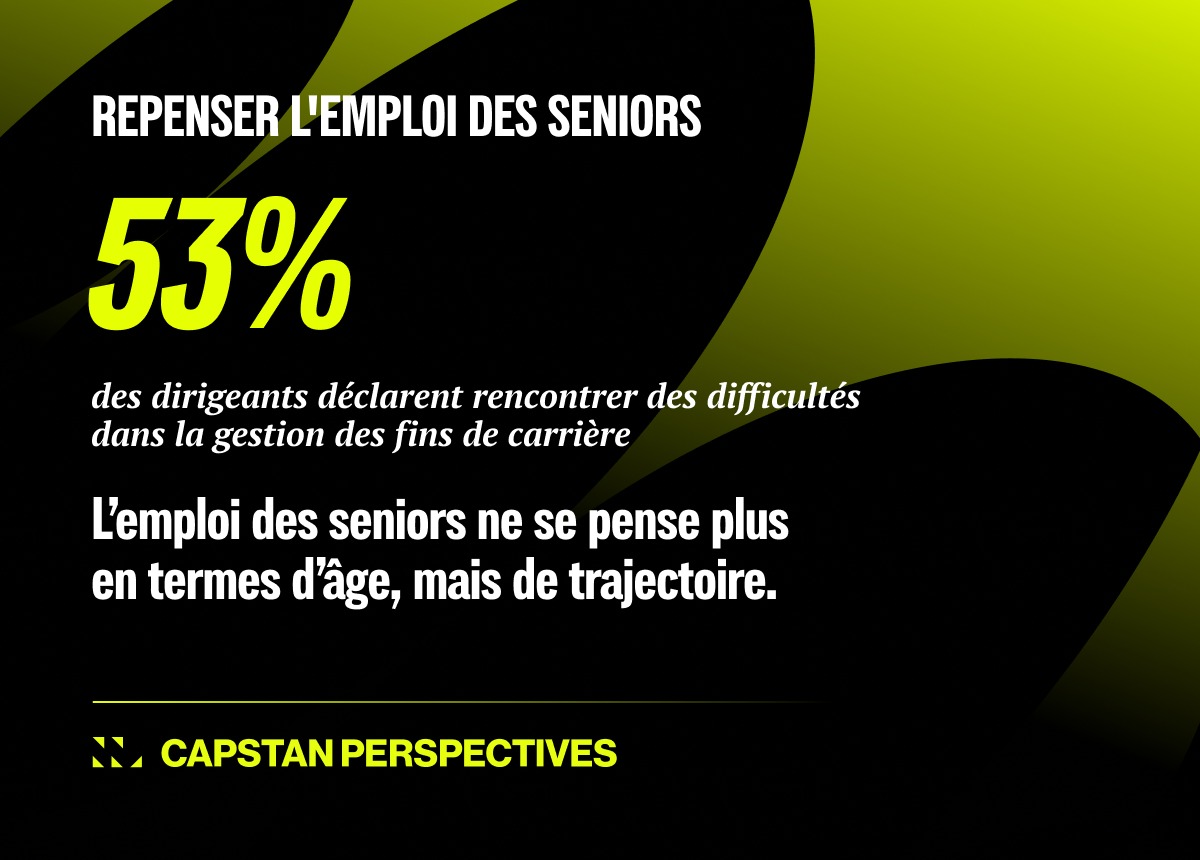Depuis sa création en 2008, la rupture conventionnelle individuelle s’est imposée comme un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à la fois souple et sécurisant. Près de 500 000 ruptures conventionnelles sont désormais conclues chaque année (voir « Le point sur les ruptures conventionnelles », Unédic, oct. 2025).
Ce succès, s’il témoigne de l’attractivité du dispositif, interroge les pouvoirs publics sur son coût pour l’assurance-chômage.
Selon la DARES, près de 75 % des ruptures conventionnelles conclues entre 2012 et 2017 se seraient substituées à des démissions de CDI (voir « La France vit-elle une « Grande démission » ? », Dares, oct. 2022). En d’autres termes, nombre de salariés auraient privilégié cette voie afin de pouvoir bénéficier de l’assurance-chômage, ce que la démission ne permet pas, sauf cas très particuliers. L’Unedic confirme que ces ruptures conventionnelles sont devenues un des principaux postes de dépenses du régime d’assurance-chômage.
L’objectif affiché désormais est donc clair : renchérir le coût de la rupture conventionnelle afin d’en réduire l’usage. Dans ce cadre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, dans sa version initiale présentée par le Gouvernement, prévoit d’augmenter de 10 points la contribution patronale spécifique applicable aux indemnités versées lors d’une rupture conventionnelle – soit un taux porté de 30 % à 40 % (voir « PLFSS 2026 : les 10 principales mesures qui intéressent les employeurs ! »).
Un postulat de base qui interroge
Le dossier de presse relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 indique que : « (…) face à l’accroissement des phénomènes d’optimisation dans les ruptures de contrat de travail, la mesure propose de rehausser de 10 points le taux de la contribution patronale qui s’applique sur les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite. Ce régime social favorable, initialement instauré pour sécuriser les sorties d’entreprise négociées et fluidifier le marché du travail a pu conduire à certains abus via des stratégies de contournement du régime social propre aux indemnités de licenciement ou à la démission de salariés ».
Le postulat gouvernemental selon lequel la rupture conventionnelle ferait l’objet d’abus, ne doit-il pas être nuancé ?
Certes, les statistiques montrent une baisse des démissions corrélée à la hausse des ruptures conventionnelles, mais cette corrélation ne nous semble pas à elle seule établir un détournement du dispositif.
En pratique, les alternatives à la rupture conventionnelle sont limitées.
Pour l’employeur, l’autre voie possible est le licenciement. Or celui-ci ouvre également droit aux allocations chômage. Dès lors, une substitution entre rupture conventionnelle et licenciement n’aura pas d’impact sur les dépenses de Pôle emploi.
À l’inverse, la démission n’est pas une option que l’employeur peut imposer.
Si la rupture conventionnelle est refusée, cela n’induit pas automatiquement une démission du collaborateur. Et si démission il y a, rien n’exclut qu’elle s’accompagne d’un contentieux… Contentieux coûteux pour les parties et pour la collectivité… L’administration de la justice ayant un prix.
A ce titre, si on doit se lancer dans un « procès » contre la rupture conventionnelle à l’aune de son coût pour le contribuable, ne faut-il pas, lui reconnaitre parallèlement une participation majeure, si ce n’est active, dans la diminution du nombre de contentieux prud’homaux, étant rappelé que l’administration de la justice a un prix, dont la rupture conventionnelle fait l’économie. ?
Enfin, doit on sous-estimer les conséquences pour l’employeur de son refus d’accepter une rupture conventionnelle ?
En pratique, un refus de rupture conventionnelle se transforme parfois en arrêt de travail… puis en déclaration d’inaptitude… ce qui conduit là encore à une rupture ouvrant droit au bénéfice de l’assurance chômage.
Une mesure dissuasive ?
Autrement dit, le raisonnement selon lequel la hausse du coût de la rupture conventionnelle à la charge exclusive de l’employeur permettra dans l’avenir d’en limiter le nombre ou d’en prévenir l’abus dans l’utilisation n’apparait pas si évidente. L’employeur, pour lequel ce mode de rupture du contrat est déjà synonyme de coût, est déjà, à notre sens, enclin à en contrôler le recours.
Dès lors, alourdir encore le coût de ce mode de rupture pour l’employeur ne devrait pas modifier le besoin ou l’envie pour le collaborateur de proposer ce mode de rupture – l’élément déterminant pour le collaborateur demeurant l’accès à l’assurance-chômage et la négociation d’une indemnité.
Dans ces conditions, ne faudrait-il pas explorer des voies complémentaires ou alternatives ?
D’autres leviers à envisager
Dans ce cadre, il n’est pas inintéressant de rappeler que L’Unedic a proposé plusieurs pistes techniques pour réguler davantage le dispositif (voir « Le point sur les ruptures conventionnelles », Unédic, oct. 2025) :
- Allongement de la durée du différé d’indemnisation des allocataires après rupture conventionnelle (passage possible du plafond actuel de 150 jours à 180 jours).
- Inclusion des indemnités légales (et non seulement supra-légales) dans le différé spécifique lié aux ruptures conventionnelles.
Ces mesures visent à agir directement sur la racine du problème pour l’Unedic, à savoir le coût pour la collectivité des ruptures conventionnelles.
A cela ne faudrait-il pas ajouter une réflexion sur la durée d’indemnisation par l’Unedic des bénéficiaires issus d’une rupture conventionnelle ? De la même manière, ne faudrait-il pas envisager une contribution spécifique pour l’employeur et le salarié à ce titre ?
Une approche combinée préférable
Au regard de ces éléments, il n’est pas certain que la seule augmentation du coût pour l’employeur des ruptures conventionnelles règle le problème de son coût pour l’Unedic.
En fin de compte, si réforme de la rupture conventionnelle il doit y avoir, ne devrait-elle pas combiner :
- une hausse de la contribution patronale et salariale pour responsabiliser les parties prenantes ;
- avec une modulation des droits au chômage (temporellement différée ou réduite) pour limiter l’effet « droit de tirage » ?
Vaste question à laquelle nous ne prétendons aucunement avoir la réponse.
En revanche, nous ne résistons pas à l’envie de soumettre à la sagacité de nos lecteurs le fruit de notre réflexion : à vouloir détériorer l’outil qu’est la rupture conventionnelle, et qui présente l’avantage de la transparence et du contrôle de l’administration, ne risque-t-on pas un report sur des pratiques plus opaques… comme par exemple, celles en vigueur avant 2008 ? C’est-à-dire celles en vigueur avant…la création de la rupture conventionnelle !?
Qui a dit que l’histoire est un éternel recommencement ?
Crédit photo : iStock.com