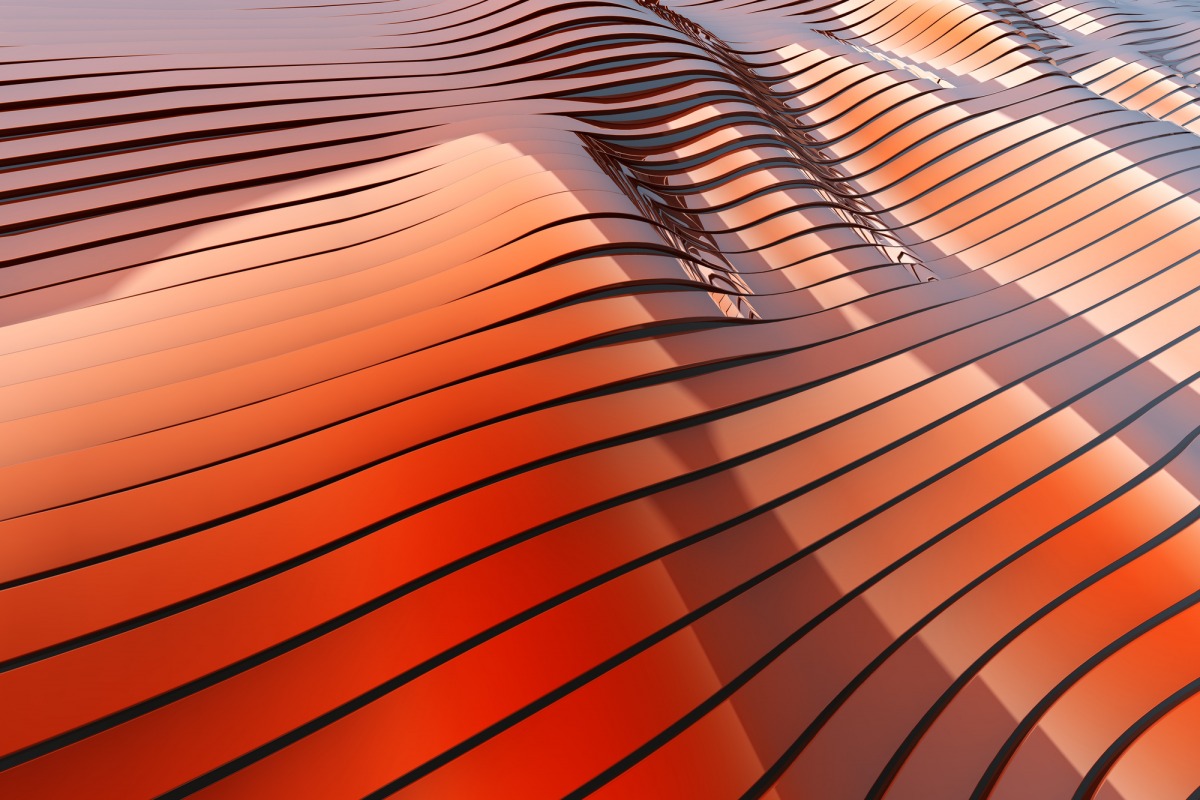Le comité d’entreprise européen (CEE) a été institué par la directive 94/45/CE, cette dernière ayant ensuite fait l’objet d’une refonte au travers de la directive 2009/38/CE.
Pourquoi une révision de la directive CEE ?
Au mois de février 2023, le Parlement européen a fait usage de son droit d’initiative et a adopté une résolution appelant la Commission à proposer une directive révisée.
Dès le mois de janvier 2024, à l’issue de deux phases de consultation des partenaires sociaux, la Commission européenne a présenté son projet de directive révisée pour des comités d’entreprise européens « plus efficaces et plus efficients » dans un objectif de renforcement du dialogue social transnational (voir « Révision de la directive relative au CE européen : quelles propositions de la Commission ? » )
Ce projet de directive a ensuite été adopté par le Parlement Européen le 9 octobre 2025 (voir « Comité d’entreprise européen : la nouvelle directive est adoptée !« ) .
Le 27 octobre, le parcours législatif du texte a pris fin avec son adoption définitive par le Conseil de l’UE.
Quelles sont les prochaines étapes ?
La directive doit encore être publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE).
A compter de cette publication, les Etats membres disposeront de 2 ans pour la transposer en droit national. Les nouvelles dispositions seront alors applicables un an plus tard.
A noter que les parties prenantes peuvent d’ores et déjà adapter les accords existants relatifs au CEE aux nouvelles exigences de la directive !
Les 10 principales dispositions de la directive révisée
La nouvelle directive apporte plusieurs modifications significatives à la directive 2009/38/CE concernant l’institution et le fonctionnement des CEE :
1. Elargissement de la notion de « question transnationale »
La directive élargit la notion de question transnationale justifiant la compétence du CEE. Elle établit une présomption de transnationalité
- dans les cas où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les mesures envisagées par la direction aient une incidence sur les travailleurs dans plus d’un Etat membre,
- mais aussi dans les cas où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces mesures affectent les travailleurs d’un État membre et à ce que les travailleurs dans au moins un autre État membre soient affectés par les conséquences de ces mesures.
2. Clarification des définitions de l’information et la consultation du CEE
Les définitions des termes « information » et « consultation » sont modifiées pour davantage de clarté :
- L’information est définie comme la transmission de données permettant aux représentants des travailleurs de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner ;
- La consultation est définie comme l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction approprié.
3. Moment et contenu de la consultation
La directive précise que la consultation « a lieu à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer leur avis avant l’adoption de la décision, sur la base des informations fournies » et « dans un délai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la question ».
De plus, les représentants des travailleurs « ont droit à une réponse écrite motivée de la direction centrale ou de tout autre niveau de direction plus approprié avant l’adoption de la décision sur les mesures en question, à condition que les représentants des travailleurs aient exprimé leur avis dans un délai raisonnable ».
4. Possibilité pour l’employeur de ne pas transmettre des informations
La directive permet à la direction centrale de ne pas transmettre des informations aux membres du CEE dans l’hypothèse où leur transmission nuirait gravement au fonctionnement des entreprises concernées. Les raisons justifiant la non-transmission doivent être précisées. Dans le cadre de la transposition, les Etats membres peuvent subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.
Une exigence de confidentialité renforcée
L’exigence de confidentialité des informations communiquées par la direction centrale est également renforcée. La direction centrale doit fournir des raisons justifiant la confidentialité et déterminer, dans la mesure du possible, la durée de l’obligation de confidentialité. L’obligation subsiste même après l’expiration du mandat des membres concernés, jusqu’à ce que les raisons justifiant l’obligation de confidentialité deviennent caduques.
5. Détermination des ressources par accord
La directive exige que les accords portant sur les CEE déterminent explicitement les types de ressources financières et matérielles alloués, y compris le recours éventuel à des experts, la prise en charge de leurs honoraires, et la fourniture de formations pertinentes aux membres des CEE.
6. Garantie d’accès à des voies de recours effectives
La directive renforce l’obligation des États membres de garantir des voies de recours effectives et un accès à la justice pour le CEE et le groupe spécial de négociation (GSN). Les frais raisonnables de représentation juridique et de participation aux procédures judiciaires doivent être supportés par la direction centrale, ou bien des mesures équivalentes doivent être prises afin d’éviter toute restriction de fait de l’accès à ces procédures au motif d’un manque de ressources financières.
7. Sanctions financières effectives, dissuasives et proportionnées
Les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect des exigences en matière d’information et de consultation transnationales. Des sanctions financières dissuasives doivent ainsi être prévues. Elles sont déterminées en tenant compte de la gravité, de la durée et des conséquences du non-respect, ainsi que des circonstances dans lesquelles il est intervenu : intentionnel ou fruit d’une négligence.
La directive précise qu’afin de rendre les sanctions dissuasives, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise ou du groupe concerné (ou que les sanctions applicables aient un caractère dissuasif similaire).
8. Protection des membres des GSN et CEE
Les membres des GSN et des CEE doivent bénéficier d’une protection équivalente à celle prévue pour les représentants des travailleurs au niveau national, notamment contre les « mesures de rétorsion » ou les licenciements.
9. Mesure en faveur de l’équilibre femmes/hommes dans les CEE et GSN
La directive introduit des objectifs spécifiques pour promouvoir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des CEE et des GSN. Les femmes et les hommes doivent composer respectivement au moins 40 % des membres de ces instances. Si cet objectif n’est pas atteint, les raisons doivent être expliquées par écrit aux travailleurs.
10. Suppression de l’exemption de mise en place d’un CEE
Enfin, la directive supprime l’exemption existant pour les entreprises qui avaient conclu un accord sur l’information et la consultation transnationales des travailleurs avant le 23 septembre 1996, c’est-à-dire avant la date d’application de la directive 94/45/CE. L’objectif de cette mesure est de permettre aux travailleurs de toutes les entreprises de dimension communautaire de demander l’institution d’un CEE.
Crédit photo : iStock.com